Beaucoup d’évocations de
l’Education aux Médias mettent en garde face aux manipulations médiatiques dont
nous serions fréquemment l’objet. « On ne nous dit pas tout ».
Mésinformation ! Pire encore, Médiamensonges. D’ailleurs, les médias
eux-mêmes sont manipulés… Certains vont même jusqu’à recourir à la
« Théorie du complot »
pour mobiliser le public et le convaincre d’une nécessaire approche critique.
Sans nier ces situations particulières, l’éducateur aux médias, lui, tente
d’alphabétiser au quotidien, partant du fait que tout média, hors même d’un
contexte manipulateur, sélectionne et traite les faits qu’il rapporte. Et cela
justifie déjà pleinement la nécessité d’une alphabétisation critique, sans
qu’il faille dramatiser outre mesure.
Qui n’a entendu parler de
l’affaire des charniers de Timisoara ? Roumanie en décembre 1989.
Emballement médiatique autour d’une macabre mise en scène pour alerter
l’opinion publique internationale. Et l’histoire des couveuses éventrées par
les forces armées irakiennes au Koweit en 1990 qui a soulevé l’opinion publique
américaine à l’heure de mobiliser les troupes contre Saddam Hussein. Vous vous
en souvenez ? Et l’interview truquée de Fidel Castro par PPDA
en 1991. Vous avez aussi sursauté quand le pot aux roses a été révélé ? Et
que dire du traitement médiatique de la grippe H1N1 et de la nécessité pour nos
pays de se provisionner en vaccins de façon massive. Une info qui a circulé
dans tous les médias avant d’être sérieusement mise en question sur le plan
scientifique. Grosse manip des industries pharmaceutiques ? Faut-il
allonger la liste des exemples qui attestent que tout n’est pas toujours au top
dans les pratiques médiatiques ? Oui, cela dérape dans la comm… Et parfois
de façon dramatique. Et parfois aussi chez les meilleurs. Loin de nous
d’ignorer ces situations. Mais en mettant le focus sur ces dérapages
magistraux, on donne à penser que l’Education aux Médias est une sorte de
militance qui s’apparenterait à une guérilla citoyenne. Il serait ainsi fait
appel à votre vigilance pour déjouer les embûches et les pièges parsemés devant
vous, de façon insidieuse par des gens sans scrupule. Mais que dire alors des
médias au quotidien ? Faut-il penser que la lecture du journal ou des
écrans (télé, GSM, Internet, consoles vidéo…) ne requiert pas d’aptitudes
spécifiques, hormis la capacité d’identifier ces dérapages, véritables
occasions alors de jeter l’opprobre sur toute la profession ? C’est un peu
facile et témoigne d’une conception très vaccinatoire de l’Education aux
Médias. Il y aurait des situations de crise, lesquelles justifieraient un
traitement de choc. Et bien sûr aussi, une prévention… laquelle éveillerait à
l’identification des symptômes de la maladie.
Pourtant, comme dans le domaine
de la santé, la meilleure prévention est encore une éducation aux principes de
base : une hygiène de vie correcte, une bonne alimentation, le respect de
ses heures de sommeil, etc. Un apprentissage qui se conçoit en dehors de, et
bien avant, tout risque d’épidémie et de contagion. Pour l’Education aux
Médias, il est possible et souhaitable de procéder de la même façon :
partir du concret du quotidien et s’approprier les principes méthodologiques.
Prenons, pour illustrer cela, une situation banale : la lecture d’un
article d’un quotidien de presse locale. Rien de particulier au premier regard.
Une situation de consommation médiatique comme il s’en présente tous les jours
au domicile d’une famille qui lit le journal.
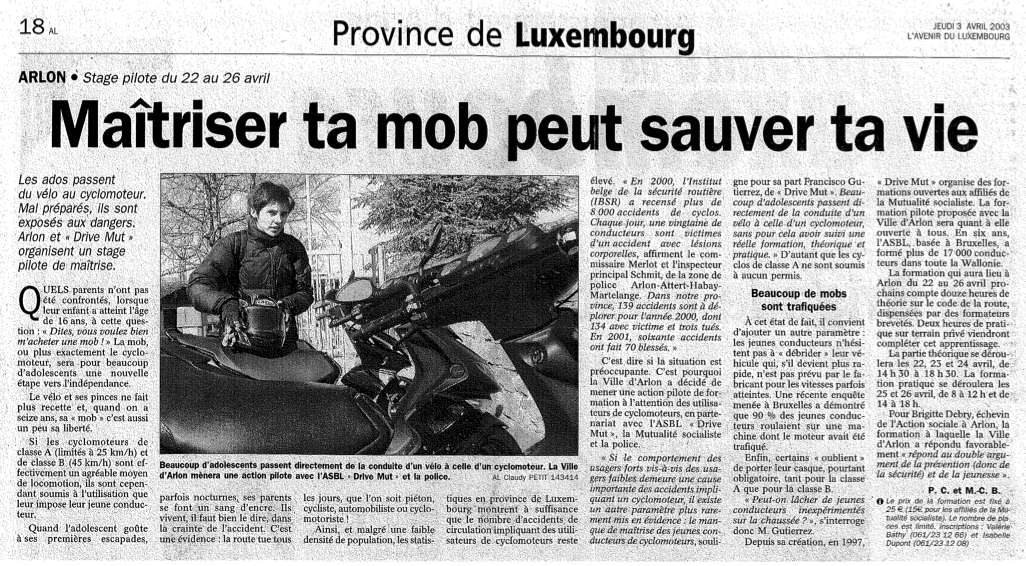
Nous avons choisi pour la
circonstance, un papier paru en 2003, précisément le 3 avril, dans l’Avenir du
Luxembourg, quotidien du groupe de l’Avenir. Son titre : « Maîtriser
ta mob. peut sauver ta vie ». L’analyse de l’article va mettre en lumière
le caractère construit de l’info qui est portée à la connaissance du public et
le fait que cette construction résulte d’une série d’options prises par le
journaliste. À chaque choix qu’il a été amené à faire, une ou plusieurs autres
possibilités auraient pu être retenues. C’est dire que l’article aurait pu se
présenter tout autrement. Eduquer aux Médias, c’est amener le lecteur à
comprendre qu’il n’y a pas une et une seule réalité dans les faits, dès qu’on les
porte à la connaissance d’un public. Chaque représentation médiatique essaye
simplement de rendre compte de faits en développant un récit parmi d’autres
possibles et en choisissant un angle d’approche. Voyons cela.
Il est question d’un stage de
maîtrise de sa mobylette organisé à Arlon à l’initiative de Drive Mut. La
session de 5 jours s’adresse aux adolescents et comporte une partie théorique
ainsi qu’une mise en situation pratique sur site sécurisé. Le programme est
soutenu par l’échevine de l’action sociale. Ce sont les services locaux des
Mutualités socialistes, partenaire opérateur du stage, qui donnent les infos
complémentaires et enregistrent les inscriptions. Voilà
pour les faits. Voyons maintenant les questions qu’il est possible de se poser
du fait de l’angle d’attaque choisi et du traitement donné par les deux
journalistes. En effet, première chose : ce sont deux signatures qui
apparaissent au bas de l’article. On peut donc imaginer que les collègues se
soient réparti le travail. En ce sens, on peut être attentif à ce qui pourrait
révéler différentes sources d’information que chacun aurait pris la peine de
consulter de son côté.
Le titre choisi (Maîtriser ta mob. peut sauver ta vie )
et son style jeune semble s’adresser aux ados. Quoi de plus normal, puisqu’ils
sont la cible du programme dont on fait l’évocation. Or, le premier
paragraphe du texte accroche le lecteur
adulte, les parents donc, sur ce qu’ils ont certainement comme expérience en
commun (et probablement avec le journaliste) : un jeune qui les tanne pour
avoir une mobylette. Et le journaliste de développer la crainte –bien
légitime ?- des parents (sans doute est-ce aussi un peu la sienne). On
attaque donc le sujet de deux façons, pour
deux publics. A la fois les jeunes concernés par le stage (dans le titre) et
(dans le paragraphe d’ouverture) les parents responsables, soucieux de la
sécurité et… généralement pourvoyeurs des finances qui vont être réclamées à
l’inscription. Le développement de l’argumentaire auquel les parents seront sensibles
passe ensuite par l’évocation des risques encourus par les jeunes : la
crainte de l’accident, la route tue tous les jours…. Des données chiffrées
récoltées auprès des services locaux de la police attestent d’accidents de
roulage où sont impliqués des deux roues motorisées. Il est fait ensuite le
relevé de quelques manquements classiques dans la conduite : port du
casque, machines trafiquées et bien sûr aussi, le manque de maîtrise… Dans la
foulée, on précise que l’association organisatrice bénéfice d’une expérience
avérée auprès de nombreux jeunes. Des chiffres annuels en attestent :
17.000 formés en six ans. Ils constitueront, on peut s’en douter, un argument
décisif lors du débat sur une éventuelle inscription. Si l’organisation
concrète est un service des Mutualités socialistes, il est aussi mentionné que
l’échevine à l’action sociale est partie prenante de ce projet. Cela donne sans
aucun doute du crédit supplémentaire à cette initiative bien rôdée qui arrête
sa caravane cette année, dans la ville d’Arlon.
À lire ainsi les choses, on peut
peut-être estimer que tout est clair et qu’il n’y a pas trente-six question à
se poser. Les faits sont là, rapportés en toute objectivité. En quoi
l’Education aux Médias est-elle concernée ? Pas d’idéologie suspecte ou
cachée. Pas de propagande. On ne peut pas craindre à ce stade, un
publi-reportage savamment dissimulé. Alors quoi ?
Partons alors de la chronologie
probable des faits. Remontons aux origines du processus qui a produit cet
article. Première série de questions : Comment le journaliste a-t-il été
mis en possession de l’info ? Qui l’a informé ? Pourquoi sont-ils
deux à traiter ce sujet ? On peut faire les suppositions suivantes :
L’info provient soit des opérateurs (Drive Mut) ou du service de l’action sociale
de la ville. Il y a sans doute plus de chance que ce soit cette dernière
version qui soit la bonne. En effet, on sait les contacts fréquents que nouent
les attachés de presse des cabinets politiques avec les journalistes. Retenons
donc cette explication : un dossier de presse, ou à tout le moins un
communiqué, informe le journal de l’organisation de ce stage (à l’approche des
vacances de Pâques) et des modalités concrètes pour s’y inscrire. Le gros du
travail journalistique est-il fait pour autant ? C’est en fait là que tout
commence. A commencer par la sélection : publie-t-on l’info ? Et, le
cas échéant, sous quelle
forme ? La décision de publier relève de la ligne éditoriale du journal. Est-ce
que cela intéressera le public ? Ici, en presse locale, difficile de ne
pas souscrire à la proposition…et délicat de refuser la perche tendue par un
partenaire –politique- de qui l’on continuera à avoir besoin demain. Un autre
élément peut entrer en ligne de compte : l’actualité du moment. En
d’autres mots encore : y a-t-il suffisamment de place pour inclure la
proposition dans les colonnes ? Si ces éléments sont favorables, il faudra
encore décider du traitement à donner à l’info. Nous ne sommes pas ici en
présence d’une simple mise en forme d’un communiqué de presse. D’ailleurs, deux
signataires attestent bien qu’un travail journalistique a été consenti. Faisons
l’hypothèse qu’un des deux a retravaillé le communiqué de base en reprenant
contact pour vérification avec les opérateurs et organisateurs. L’autre journaliste
alors, de quoi s’est-il chargé ? La réponse semble logique : les
infos chiffrées récoltées auprès de la police locale. Au minimum, un coup de
téléphone. Peut-être un déplacement à la gendarmerie ? Les infos
complémentaires demandées vont dans le sens de crédibiliser l’a propos d’un
stage de ce genre en province luxembourgeoise. Quant au traitement de l’info,
nous avons vu comment il a été développé : les deux publics, les risques
réels que le stage va essayer de rencontrer… Un autre traitement était-il
possible ? Comme Cyrano dans la tirade des nez, « on pouvait dire
bien des choses en somme ! »
L’article aurait pu être écrit
uniquement à destination des jeunes, ou à l’inverse exclusivement tournés vers
les parents. On aurait pu donner la parole à des familles dont des enfants
auraient eu un accident à mobylette. Faire parler plus longuement un des
policiers chez qui l’on a récolté les chiffres statistiques et lui demander
d’évoquer les accidents de roulage… ou plutôt de lister les risques, notamment
financiers, que l’on court à contrevenir au code de la route. On aurait pu
interviewer un concessionnaire de mobylette de la région sur le trafic des
bécanes auquel se livre volontiers les jeunes. On aurait pu donner la parole à
un des instructeurs pour qu’il décrive le programme du stage. Il aurait été
aussi intéressant de publier le témoignage d’un jeune ayant déjà suivi le stage
lors d’une session précédente et qu’il puisse dire tout l’intérêt du stage. On
aurait pu, on aurait pu…
On le voit, cette info de base,
(un stage de maîtrise est organisé) aurait pu être présenté de mille façons.
Mais à chaque fois, on cible un public différent, et on donne une image
différente du stage. Pour ce faire, il faut alors recourir à des procédés
différents, à la fois dans l’écriture mais aussi dans la mise en forme. Ainsi,
prenons comme exemple la photo qui a été choisie pour illustrer l’article. La
note de crédit mentionne « AL. Claudy Petit 143414». Une photo maison donc
(A.L. = Avenir du Luxembourg). Que représente-elle ? Un ado devant un rang
de mobylettes à l’arrêt. Première
chose : il est difficile de dire si c’est une fille ou un garçon… C’est un
bon choix puisque le stage ne fait pas non plus de discrimination. Le jeune est
occupé à chausser son casque et ses gants. En l’occurrence, c’est un bon
exemple ! On aurait pu à l’inverse, choisir un jeune en défaut
d’équipement réglementaire. La photo a été prise dans un parking, mais on
aurait pu flasher en situation de roulage. En situation conforme ou, à l’inverse,
en situation de danger. On aurait pu faire dans le trash en photographiant un
accidenté… qui s’en sort encore pas trop mal (du genre avec un plâtre et des
béquilles) ou un mort étalé sous une couverture à même le macadam ! Et la
légende rédigée aurait pu décliner toute la panoplie allant des bons conseils
de roulage aux remarques condescendantes post accident, en passant par le
rappel du code de la route ou la redondance des chiffres statistiques
mentionnés dans l’article.
Le papier tel que rédigé est un
article classique, écrit à quatre mains. Il aurait pu être une interview (un
instructeur, un jeune, un parent, un garagiste ou l’échevine elle-même
interrogée sur sa politique familiale). Cela aurait pu aussi être un reportage
photos. A minima, le journal aurait pu se contenter de mentionner le stage dans
une longue série de propositions occupationnelles en cette période de congés
scolaires. A maxima, le journal aurait pu se positionner encore plus
favorablement par rapport à l’événement en tentant d’obtenir une place gratuite
à offrir comme prix d’un concours portant sur la connaissance du code de la
route, par exemple. C’est fou ce que l’on peut envisager, si l’on est
créatif !
Mais, un autre élément entre en
ligne de compte dans tout travail journalistique : l’heure du bouclage.
Nous sommes ici dans un quotidien et non un périodique. Si la parution de
l’info est prévue dans le numéro du lendemain… le bouclage, c’est en fin de
journée. Pas de recul possible. Si les renseignements ne tombent pas rapidement,
après visite sur site ou coup de téléphone, c’est foutu ! Chercher un
jeune qui a déjà suivi le stage n’a peut-être pas été possible dans le temps
imparti. Interviewer l’échevine non plus, car elle était peut-être retenue en
réunion ou en déplacement ce jour ! Et donc… on fait aussi avec ce que
l’on a, quitte à revenir demain ou un autre jour sur le sujet. En l’occurrence
à la fin de la semaine, pour faire un écho du succès de participation à la
session, par exemple.
Alors, notre papier qui semblait
si anodin et ne représentait pas un risque majeur en matière d’Education aux
Médias alarmiste ? N’est-il pas une invitation à se poser toute une série
de question et à faire preuve d’une réelle compétence de lecture
médiatique ? Si l’on est en mesure de relever les caractéristiques d’une
expression médiatique en pressentant aussi ce que d’autres choix rédactionnels
auraient donné, on montre alors que l’on est lecteur expérimenté du journal, un
consommateur averti et actif qui réfléchit et sait faire preuve d’esprit
critique.
Annexe : un fichier photo
(stagearlon.jpg) de l’article